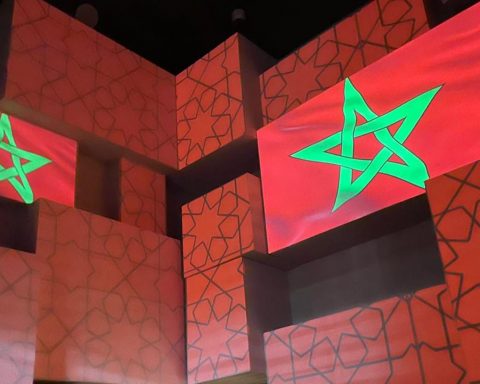Nigeria – Assis sur des nattes, quatre hommes aux frêles silhouettes battues par le vent du désert cousent de petits chapeaux traditionnels, histoire de rompre l’ennui. Non loin, les femmes font bouillir des marmites et les enfants jouent entre les abris de tôle érigés sur la terre sèche.
Dans le Nord-Est du Nigeria, la scène est banale. Elle se répète à l’infini dans les innombrables camps qui accueillent quelque deux millions de déplacés fuyant l’insurrection jihadiste de Boko Haram.
Mais ce n’est pas vraiment l’avenir qu’avaient imaginé Aliyu, Abubakar, Muhammad et Mallam – dont les noms ont été changés par mesure de sécurité: présentés comme d’anciens combattants du groupe islamiste Boko Haram, ils ont intégré le programme de “déradicalisation” du gouvernement nigérian.
Après des années de détention traumatisantes, selon eux, dans des cellules sales et surpeuplées, les quatre hommes ont fini par échouer dans ce camp, sans argent ni travail, bien loin du nouveau départ que leur avait promis le gouvernement.
Le Nigeria a lancé en 2016 l’Opération “Safe Corridor”, offrant la possibilité de déposer les armes à ceux qui se portent volontaires. Il mène en parallèle des offensives militaires contre les insurgés de Boko Haram et de sa branche dissidente, L’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap). Le conflit a fait plus de 40 000 morts en 10 ans.
Mais tous ne sont pas éligibles. Les profils des combattants sont d’abord passés au peigne fin pour sélectionner ceux qui présentent une menace “faible”, avant leur transfert dans un centre de déradicalisation à Mallam Sidi, une ville de l’Etat de Gombe (Nord-Est).
Pendant six mois, ils sont censés suivre des cours d’alphabétisation, une formation professionnelle et religieuse et reçoivent une aide psychosociale.
Les Etats-Unis, l’Union européenne et la Grande-Bretagne ont déboursé des millions de dollars pour financer le programme, soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et coordonné par l’armée nigériane.
Détenus par «erreur»
Pour son patron, le général Mohammed Maina, “l’opération Safe Corridor a enregistré d’énormes succès”.
“Plus de 800 ex-combattants repentis ont été déradicalisés, réhabilités et réintégrés avec succès”, a-t-il assuré dans une réponse écrite à l’AFP début juillet.
D’autres pourraient bientôt suivre: l’armée a annoncé début août examiner les cas de 335 combattants qui se sont récemment rendus.
Pourtant, d’après les quatre hommes rencontrés, le parcours de sortie est assez éloigné de la version officielle: ils affirment avoir été détenus pendant des années sans faire l’objet de poursuites et dans des conditions très rudes, avant de pouvoir accéder au programme de réhabilitation.
Pire, deux d’entre eux, Abubakar et Mallam se présentent comme des cultivateurs n’ayant jamais collaboré avec les jihadistes et détenus à tort avec beaucoup d’autres citoyens ordinaires, y compris des enfants.
Leurs parcours individuels sont difficiles à vérifier, mais ces dernières années, plusieurs rapports, notamment de l’Agence américaine de développement (Usaid) et de l’ONG Amnesty International, ont documenté des centaines de témoignages similaires.
Dans un rapport publié cette année, le think-tank International Crisis Group (ICG) rapporte que, selon les personnes ayant suivi le programme qu’il a interrogées, pas plus d’un quart des pensionnaires du centre de réhabilitation étaient réellement membres de Boko Haram
“La plupart des autres (…) sont des civils ayant fui les zones contrôlées par Boko Haram, que les autorités ont considéré à tort comme des jihadistes et détenus avant de les inclure dans Safe Corridor”, affirme le rapport.
Des allégations démenties par le général Maina: “les ex-combattants sont sélectionnés après un profilage et une enquête approfondis”.
Par ailleurs, selon une source très bien informée et ayant requis l’anonymat, plusieurs dizaines d’ex-combattants de haut rang — dont des commandants — sont également passés par le centre de déradicalisation de Gombe, dans le cadre d’un programme différent.
«Pris au piège»
Abubakar, 48 ans, cultivait ses champs et ne manquait de rien, jusqu’au jour où Boko Haram a envahi son village de l’Etat du Borno, épicentre de l’insurrection.
A partir de ce jour-là, “mes revenus ont commencé à diminuer parce qu’ils prenaient nos récoltes (…) même la nourriture que nous préparions”, raconte ce père de trois enfants.
“Ils nous observaient, nous surveillaient (…) nous étions pris au piège. Nous n’avions pas le choix, ils avaient des armes.”
Mallam, 52 ans, cultivait du sorgho et des haricots dans un autre village du Borno.
Quand ils sont arrivés, les jihadistes ont ordonné aux hommes de laisser pousser leur barbe et aux femmes de rester à la maison. Il raconte avoir une fois reçu 80 coups de fouet pour avoir acheté des cigarettes.
Les deux agriculteurs ont décidé de s’échapper avec leurs familles.
“Nous sommes partis au milieu de la nuit (…) Nous étions une centaine”, affirme Abubakar qui avait entendu à la radio le gouvernement appeler les civils à quitter les zones occupées par Boko Haram.
Malgré la peur d’être capturés par les djihadistes, rester n’était pas une option.
“Nous savions qu’un jour ils nous tueraient parce que nous ne les acceptions pas”, explique Mallam, qui a cinq enfants.
Mais une fois en territoire contrôlé par l’armée, les deux agriculteurs affirment avoir été arrêtés. Soupçonnés de soutenir les insurgés, ils ont été emmenés à la caserne de Giwa, aux conditions de détention tristement célèbres, à Maiduguri, la capitale du Borno.
Ce ne serait que la première étape d’un long parcours carcéral.
«Pas de nourriture, pas de toilettes»
Abubakar et Mallam assurent y avoir passé respectivement huit et quatre mois.
“Il n’y avait pas de nourriture, pas de toilettes, des parasites partout (…) les gens mouraient tous les jours”, raconte Mallam.
Abubakar et son fils de 13 ans occupaient une cellule avec 450 personnes. “Nous devions tous nous tenir debout tellement c’était plein”, se souvient-il.
Puis ils ont été séparés. Mallam assure avoir appris la libération de son fils au bout de quelques mois à Giwa, seulement six ans plus tard, à sa sortie du programme.
En 2016, Amnesty avait accusé l’armée de détenir en masse et sans “aucune preuve” des membres et sympathisants présumés de Boko Haram sur des sites militaires, tels que Giwa.
“Ils ont dû être impliqués, volontairement ou non”, a réagi le porte-parole de l’armée, Onyema Nwachukwu, à propos des agriculteurs Mallam et Abubakar. “Nous ne détenons pas les gens de manière arbitraire”, a-t-il déclaré à l’AFP.
Pour les militaires, tout activité consistant à fournir des vivres, du carburant ou des médicaments à Boko Haram, même sous la contrainte, suffit à rendre quiconque suspect.
D’après M. Nwachukwu, l’armée “n’arrête pas les enfants” mais les femmes détenues après avoir rejoint les rangs de Boko Haram demandent parfois à garder leurs enfants avec elles.
«Se battre était notre devoir»
Les anciens combattants Aliyu et Muhammad ont eux aussi séjourné à la caserne de Giwa après leur rédition, et en gardent un souvenir amer.
“Ils nous ont dit que nous allions passer deux à trois mois à Giwa (…) mais cela s’est transformé en 18 mois”, a déclaré Muhammad. “C’était vraiment horrible”.
Aliyu avait 18 ans lorsqu’un voisin a commencé à lui parler du “gouvernement corrompu”, à lui enseigner sa vision de l’islam et à lui donner de l’argent. C’est comme ça qu’il s’est “radicalisé”.
Un jour, il a quitté village et parents, jusqu’à la forêt de Sambisa, principal fief de Boko Haram.
Après avoir étudié le Coran et s’être formé au maniement des armes, Aliyu, aujourd’hui âgé de 28 ans, est devenu trafiquant d’armes, puis combattant, prenant part à de “grandes attaques”.
“Nous l’avons fait à cause de la religion”, assure-t-il. “C’était notre devoir”.
Muhammad, 25 ans, était encore enfant et mendiait dans la rue quand il a rencontré un prédicateur qui lui a parlé de Mohammed Yusuf, le fondateur de Boko Haram.
L’homme, devenu son mentor, l’a envoyé dans une école religieuse à “Fallujah” – les jihadistes nigérians donnent souvent aux lieux des surnoms irakiens ou afghans – avant de partir pour le “jihad”.
“J’étais impatient de me battre”, raconte Muhammad, alors analphabète. “Je comprenais que nous étions en guerre contre le gouvernement. On nous enseignait que c’était la bonne voie.”
Tous deux disent avoir fait partie de Boko Haram pendant environ six ans, mais peu à peu, l‘engouement du début a fait place au doute face à l’attitude de leurs compagnons d’armes.
“Ils faisaient des choses sans raison (…) tuer, voler, ce qui est contraire aux enseignements religieux. Et j’en ai vu certains prendre de la drogue”, raconte Muhammad.
À l’époque, la contre-offensive de l’armée nigériane, grâce au soutien militaire des pays voisins comme le Tchad et le Cameroun, lui permet de reprendre certains pans de territoire occupés par les insurgés.
Quand les deux apprenti-jihadistes entendent parler de l’opération “Safe corridor”, et de la possibilité de suivre une formation professionnelle, ils décident de franchir le pas.
Mais ils devront attendre près de deux ans avant de pouvoir rejoindre le programme de déradicalisation.
«Alternatives viables»
Le porte-parole de l’armée, M. Nwachukwu, reconnaît que le processus n’est “pas automatique”, estimant qu’il faut du temps “pour s’assurer qu’ils ont véritablement abandonné la lutte”.
Les donateurs et partenaires internationaux ont émis de nombreuses critiques sur le “profilage” qui vise aussi à repérer les suspects de plus grande envergure en vue d’éventuelles poursuites.
Cela “reste opaque, sans supervision indépendante, sans archivage ni définition publique des critères de sélection”, a souligné l’Usaid dans un rapport.
Les repentis Muhammad et Aliyu disent que l’essentiel de leurs codétenus n’étaient pas des jihadistes.
“Dans ma cellule de 260 personnes, nous étions 12 vrais Boko Haram”, assure Aliyu.
“C’est franchement de l’injustice”, renchérit Muhammad. Parmi ses 300 co-détenus, “les vrais Boko Haram n’étaient pas plus de 20”.
L’AFP n’a pas pu vérifier ces chiffres. Le directeur du programme, M. Maina, assure que le processus de vérification à Giwa “est peut-être imparfait, mais il est toujours très minutieux”.
Dans des documents officiels consultés par l’AFP, le gouvernement nigérian reconnaît que certains “collaborateurs” – volontaires ou contraints- de Boko Haram sont victimes de l’insurrection, mais affirme que Safe Corridor leur offre des “alternatives viables”.
Après Giwa, pour la deuxième phase de leur détention, les agriculteurs Abubakar et Mallam ont été transférés à la prison de haute sécurité de Maiduguri, où ils ont passé trois années de plus sans être inculpés.
“J’espérais que les militaires me protègent, mais ça a été le contraire”, dit aujourd’hui Abubakar.
Aliyu, Muhammad, Abubakar et Mallam sont finalement arrivés à leur destination: le centre de réhabilitation de Gombe. Pendant un an, ils ont pu apprendre à lire et écrire, la menuiserie et la soudure ou encore s’entretenir avec des éducateurs sociaux.
“Nous pouvions dormir, nous avions des moustiquaires, des oreillers”, explique Abubakar.
Ils ont lu des textes qui contredisent le discours jihadiste. Les deux ex-combattants admettent que le programme a modifié leur point de vue.
“Aujourd’hui, si quelqu’un voulait partir faire le jihad, je lui dirais +suis ta propre religion chez toi, mais ne va pas te battre+”, a déclaré Aliyu.
“Ils (Boko Haram) ont trahi ma compréhension du jihad pour servir leurs intérêts personnels”, assène Muhammad.
Mais pour les deux agriculteurs, Abubakar et Mallam, le séjour à Gombe n’était qu’une détention prolongée de plus: “nous avons été envoyés là-bas pour souffrir”, s’insurge Mallam.
Pas de travail
Quel avenir attendait finalement ces hommes après toutes ces années passées derrière les barreaux et au centre de déradicalisation?
Après avoir prêté allégeance à l’Etat nigérian et promis de ne pas retourner combattre, les pensionnaires de Gombe reçoivent généralement 20 000 nairas chacun (environ 42 euros) et sont envoyés dans un centre de transit avant d’être libérés.
“Des liens sont établis avec les communautés” pour préparer leur retour et les autorités locales sont chargées d’assurer leur réintégration, selon M. Nwachukwu.
Lorsque Mallam a retrouvé sa femme après presque cinq ans de détention, la faim l’avait complètement transformée.
“Elle avait vécu dans un camp où il n’y a pas de nourriture (…) Mes parents sont morts et tous nos enfants souffrent de malnutrition.”
Même les anciens combattants Aliyu et Muhammad, qui répondaient aux critères d’anciens combattants à “faible risque” et ont bénéficié d’une amnistie, remettent en cause la réussite du programme.
Ils vivent désormais comme des parias et gagnent à peine un euro par jour dans un camp de déplacés, sans perspective d’avenir, stigmatisés par leur communauté.
“Ils nous ont parlé d’emploi, mais au final, il n’y a pas d’emploi”, regrette Muhammad. “Quel type de vie est-ce là ? Je regrette de m’être rendu”.
Dans cette région ravagée par le conflit, où 4,3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire selon l’ONU, les millions de dollars investis pour réhabiliter les anciens combattants sont parfois très mal vus par la population qui manque de tout.
“Les efforts de réintégration sont louables (…) mais il y a beaucoup d’animosité, les gens sont en colère”, explique Mariam Oyiza qui dirige une association soutenant les femmes victimes de violences.
Malgré tout, alors que des centaines de défections ont été enregistrées ces derniers mois, le gouvernement fédéral et les donateurs espèrent que le programme encouragera des milliers d’autres insurgés à déposer les armes.
Pour cela, les autorités nigérianes doivent montrer qu’elles “sont capables d’accompagner les détenus jusqu’à l’obtention de leur diplôme et de les réintégrer dans la société en toute sécurité”, estime l’ICG. “À ce jour, Safe Corridor n’est pas en mesure d’offrir ce type d’assurances”.